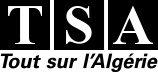Ce fut donc l’année de Saphir Taïder, Aïssa Mandi et Yacine Brahimi, l’année de la Coupe du monde et du fauteuil roulant, l’année du dixième anniversaire de l’assassinat du Matin, que H’mida Layachi, directeur des deux quotidiens, El Djazaïr News et Algérie News, apprit la mort de ses deux journaux. La sentence fut dite, simplement, par Abdelkader : « Suspendus pour retard de paiement ! ». C’est plus solennel que de dire : « Suspendus pour avoir écrit contre le quatrième mandat de Bouteflika ! » ou « Suspendus pour avoir soutenu le mouvement Barakat ».
Tout le monde sait que le régime algérien est au-dessus de ces basses manœuvres d’État bananier. Abdelkader, plus connu sous le nom de Metchat, est responsable de la SIA. Derrière ce sigle joliment trompeur se cache une institution stratégique de l’État algérien, la Société d’impression d’Alger. Ici, on tire quotidiennement les gazettes destinées à la populace, on en égorge parfois quelques-unes, selon les humeurs, la situation politique, la position des clans à l’intérieur du régime, autant de casse-tête qui déterminent la quantité de fausses vérités et de vrais mensonges à administrer régulièrement aux braves Algériens afin qu’ils continuent de porter complaisamment le joug de la félicité publique. Mais Abdelkader maîtrise son sujet. Voilà vingt ans qu’il occupe ce poste de directeur de la SIA. De la SIA, pas d’une imprimerie. Ne dites surtout pas à Abdelkader qu’il est directeur d’imprimerie. Cela le vexerait. Abdelkader dirige une imprimerie d’État. Et diriger une imprimerie d’État, objecte-t-il à qui veut l’entendre, est un métier. Il veut dire un métier qui ne ressemble à aucun autre, surtout pas à celui de directeur d’imprimerie. Notre homme, en effet, ne court pas les places commerciales à la recherche du papier bon marché ou d’une encre pas trop chère ; il n’est pas tourmenté par les échéances de fin de mois, les salaires à régler, les fournisseurs à payer, les livres comptables à tenir… Abdelkader est étranger à ces vulgaires préoccupations d’intendant, la rentabilité, le bénéfice, l’équilibre des comptes… Du reste, personne ne lui demande d’être rentable, bénéficiaire ou je ne sais quoi. Diriger une imprimerie d’État suppose une noblesse bien au-dessus de ses basses considérations d’apothicaire.
Le métier d’Abdelkader est double : imprimeur et homme du système. Il imprime ou suspend selon les instructions. Et à ce poste, on dure longtemps, si on a le génie de ne s’aliéner aucun clan contre soi.
2
La suspension des deux journaux de Hamida Layachi fut accueillie, dans la cité heureuse, par l’indifférence glaciale d’une confrérie désormais sans état d’âme. Comme dans Oran du temps de la peste, dans la cité des affaires, il n’y avait pas de place pour la conscience, seulement pour les affaires, le football et la santé du petit dernier, « je ne vous dis pas … ». Du reste, on en avait fini avec ce souvenir du Matin. On était, enfin, passé à autre chose. Seul le nom est resté gravé dans les mémoires. On se souviendra du Matin, pas de ses fossoyeurs, dit-on. Peut-être. Mais la page était tournée. On avait oublié. Pendant dix ans, il a fallu apprendre à vivre sans le remord, à se regarder dans une glace le matin, à se persuader qu’il l’avait bien cherché, ce vilain petit canard, à jeter ainsi des pavés dans la mare vaseuse du régime. La suspension du Matin avait fait consensus au sein des clans du pouvoir comme parmi les coteries qui forment la singulière corporation de journalistes : elle sanctionnait l’illusion d’un journalisme qui prétendait défendre les principes d’un État de droit, sans réaliser que cet État de droit, inexistant, était remplacé par les réseaux d’affaires et les lobbies.
« Suspendu pour cause de retard dans le paiement des factures d’imprimerie ! », avait tranché, en public, le Premier ministre de l’époque. Peu importe si Le Matin l’un des deux seuls journaux à s’acquitter régulièrement de ses factures auprès de l’imprimerie Simpral. Régler ses factures ne suffit pas pour échapper à la suspension d’impression. Du reste, personne ne l’exigeait vraiment. Ce qui était attendu du journal, c’était de se mettre sous la protection d’un des clans qui forment l’État algérien et d’évoluer à l’intérieur d’un échiquier politique.
Le Matin était le plus gros payeur de l’imprimerie Simpral pendant que d’autres titres rasaient gratis. Privilège des journaux bataglia. Les journaux du harem médiatique. Un harem ? Je devine les yeux ronds : « Cela existe, un harem, dans le monde de la presse ? » Dans le monde de la presse, je ne sais pas, mais dans le monde de la presse algérienne, cela existe bel et bien. Le régime algérien s’est offert un appareil de propagande et de désinformation réglé pour camoufler sa nature rentière et mafieuse. Les journaux du harem ont pour fonction de réguler l’information au profit du régime, créant le contrepoids indispensable à « l’autre information ». Ils créent une réalité médiatique à une démocratie inexistante.
Abdelkader définit ainsi les journaux du harem : « Certains journaux ont des dettes de deux ans. D’autres de trois ans. Cela dépend de chaque publication. Chacun avait quelqu’un derrière lui qui le soutenait et intervenait pour lui. Vous faites une mise en demeure à un journal ? On vous appelle pour vous dire : qui t’a dit de la faire ? ».
En contrepartie de leur besogne, les journaux du harem reçoivent prébende et protection. L’argent est le principal motif de l’allégeance. On sait que, sous l’empire ottoman, le sultan devait verser à chacune de ses concubines des sommes très importantes. Cette rémunération s’accomplissait, pour ce qui concerne la presse algérienne, par l’argent de l’Anep mais aussi, et quoi qu’en pense Abdelkader, par la dispense du règlement des factures d’imprimerie. L’argent qui servait à rémunérer la servilité des uns, le silence des autres et la complicité de certains, cet argent, l’argent de l’Anep, tout le monde le savait, était un peu de l’argent sale, l’argent extorqué à des institutions publiques et à des entreprises d’État forcées de payer rubis sur ongle des placards publicitaires dans des canards boiteux que personne ne lit, un peu à la manière de Don Fanucci, le racketteur membre de « La Main Noire », raconté par le film « Le parrain », qui extorquait des paiements de protection aux commerçants du quartier. C’est ce qu’on appelle le Pizzo dans le jargon mafieux, une somme d’argent extorquée aux entrepreneurs et aux commerçants en échange de la protection.
3
C’est pour le Pizzo que Hamida Layachi a fait le choix d’intégrer le harem médiatique du sultan. Il nourrissait, sans doute, l’idée secrète de pouvoir échapper à ses contraintes. Erreur ! Pour avoir droit à sa part du butin, il fallait faire le dos rond, cracher sur le métier de journaliste, enfiler la tenue de soubrette et, pour certains, jouer à l’informateur. Le harem est un univers clos bâti sur la loi du silence, la vénération et la crainte du maître. En entrant dans le harem du sultan, on doit accepter de laisser son ancienne vie au pas de la porte et de mettre la tenue de potiche. Le terme n’est pas exagéré. Nous nous souvenons tous de ces directeurs de publication algériens que le chef de l’État plaçait derrière les journalistes étrangers lors des entretiens avec ces derniers et à qui il était strictement interdit de prendre la parole. Ils étaient là pour le décor ! Le tableau, tout ce qu’il y avait de plus humiliant pour la presse algérienne, évoquait les geishas, ces dames de compagnie que l’on chargeait, au Japon, de tenir compagnie aux hôtes de marque. Était-ce le message que voulait délivrer El-Mouradia ? Il n’est pas interdit de le penser, tout comme il est permis de s’interroger sur le sens caché de la formule « Tayabet el hamam », quand on sait le rôle du hammam dans la formation des concubines du harem.
Hamida Layachi n’ignorait rien de tout cela. Il est sans doute l’un des journalistes les plus cultivés de la presse nationale. Je l’avais laissé rédacteur en chef du quotidien El-Youm. Il m’avait longtemps parlé de Chomsky, figure intellectuelle majeure du monde contemporain dont il admirait la pugnacité et l’esprit indépendant. Il m’avait offert un des livres du linguiste, écrit conjointement avec son ami Herman, La Fabrication du consentement, s’attardant sur les mécanismes qui conduisent, dans le contexte américain, les principaux médias à participer au maintien du système en place et de l’ordre établi. Je l’ai retrouvé, quelques années plus tard à la tête de deux quotidiens, El Djazaïr News et Algérie News, et il m’avait, cette fois, offert un déjeuner au Karakoya, à Alger où il y avait table ouverte.
Il a vécu ainsi dix ans coincé entre Chomsky et le sultan. Le premier considère que « les intellectuels qui gardent le silence à propos de ce qu’ils savent, qui se désintéressent des crimes qui bafouent la morale commune, sont encore plus coupables quand la société dans laquelle ils vivent est libre et ouverte. Ils peuvent parler librement, mais choisissent de ne rien en faire. » Le second tient à faire des créatures du harem sa propriété.
À suivre