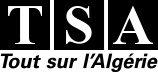Daho Djerbal est maître de conférences en histoire de l’Algérie contemporaine à l’Université d’Alger. Il est également directeur de la revue Naqd dont il est l’un des fondateurs. Dans cet entretien, il revient sur le 60e anniversaire du déclenchement de l’histoire de la guerre de Libération, la participation des Oulemas et de Messali Lhadj et son instrumentalisation par les politiques.
L’Algérie fête samedi le 60e anniversaire du 1er novembre 1954. Pourquoi les Algériens ne se sentent-ils pas concernés par les festivités ?
Ceux qui sont concernés par l’indépendance n’ont plus le droit à la parole. Ils ne sont plus maîtres des médias et des moyens de communication. Ces derniers sont entre les mains d’autres gens que ceux qui représenteraient l’idéal du 1er novembre. Et puis, je pense qu’il ne faut pas confondre tous les Algériens comme s’ils représentaient un ensemble homogène. Toutes les générations ne peuvent pas répondre à votre question de la même façon. Et les uns ont la possibilité de s’exprimer et les autres n’ont pas cette possibilité. Les uns savent, les autres ignorent. Enfin, il ne s’agit que d’un apparent manque d’intérêt parce que beaucoup d’Algériens ont intérêt à ce que l’Algérie reste indépendante, libre et souveraine, mais ils n’ont pas les moyens de l’exprimer clairement.
Quel regard portez-vous sur l’enseignement de l’histoire de la guerre de Libération dans l’éducation nationale et à l’université ?
Je n’ai pas fait une étude du contenu du manuel scolaire ; cependant, ce dont je peux parler c’est du résultat de la formation dans les différents cycles du système éducatif, que ce soit au collège ou au lycée. Quand les étudiants arrivent à l’université, ils n’ont même pas une connaissance approximative de l’histoire de leur propre pays. Je ne vous parlerai donc pas de leur connaissance de l’histoire en général ou de leur rapport à la géographie et par conséquent de leur rapport à l’espace-temps. Tout cela est complètement à reconstruire à l’université. Et on se retrouve avec des missions qui ne sont pas les nôtres.
Nous avons des étudiants qui sont nés en 1993, en 1994 et en 1995. Ce qu’ils vont avoir comme héritage transmis par leurs propres parents, c’est quasiment un silence sur le passé. Un silence traumatique. Et à l’école, ils vont avoir comme seule acquisition une histoire officielle. De 1962 à ce jour, le régime politique a tout fait pour remanier la narration de la guerre de Libération. Après l’indépendance, nous avons eu la transformation du Front de libération nationale en Parti du FLN. Un parti unique qui a été amené à écrire sa propre histoire et à la légitimer. Une version qui serait une version officielle dont le seul auteur est le parti unique. Une sorte de légitimation a posteriori de l’autorité et du pouvoir.
Et avec cette version officielle, on se rend compte qu’un certain nombre de figures du mouvement de libération nationale et un certain nombre de composantes du mouvement ne vont pas se retrouver dans le manuel scolaire. Et on s’aperçoit au fur et à mesure que le temps passe, que parmi ceux qui nous gouvernent, certains n’ont rien à voir avec ce passé, d’autres n’ont pas toujours eu une position honorable dans les conflits et les crises qui ont agité le Mouvement de libération de manière générale dans les années 1940 et 1950 et même dans la guerre de Libération de 1954 à 1962.
Quels sont ces personnages et ces chapitres entiers de la guerre de Libération dont on ne parle pas ?
Je prends en exemple Messali Hadj. Lors de mon premier cours aux étudiants du département d’histoire d’Alger, j’ai fait une introduction générale où j’ai notamment parlé de Messali El Hadj. Un étudiant m’a lancé : c’est un traitre ! Une affirmation péremptoire presque spontanée sans l’ombre d’un doute. Pourquoi cela ? Parce que c’est l’image qui a été transmise de ce personnage, par l’école et par le qu’en dira-t-on. Une idée véhiculée systématiquement consistant à dire qu’il y a eu trahison de Messali par rapport au projet de libération nationale. Or, à aucun moment, Messali Hadj ne s’est allié aux Français pour combattre le FLN. Aucun texte, aucun document pouvant l’attester n’existe là-dessus. Deuxième exemple, la position des oulémas par rapport au 1er novembre 1954. Aujourd’hui, les oulémas sont présentés comme étant ceux qui ont formé, préparé et inclus dans les esprits des Algériens la nécessité de la lutte armée pour la libération. C’est absolument faux ! Les oulémas ont refusé de participer à la guerre de libération au début de son déclenchement.
Le massacre de Melouza et de la guerre fratricide au sein du Mouvement national fait partie de ces non-dits…
En ce qui concerne le massacre de Melouza, un des responsables de l’ALN de la wilaya III a pris sur lui de considérer tout un village comme traître. Pas seulement parce que ce village (Melouza) était du MNA mais parce qu’il a refusé ou émis des réserves quant à la prise en charge d’une unité de l’ALN qui passait par là. Donc, il fallait couvrir après coup une dérive qui n’avait pas été décidée ni assumée par la direction du FLN/ALN. Il faut savoir que ces faits ont déjà été posés à l’époque. La question de la responsabilité collective et des nuits rouges où l’on massacrait tout un village ont été posées au Congrès de la Soummam et bien avant cette date par Bachir Chihani en zone 1 avec la désignation des responsables, leur jugement et parfois leur condamnation. Sauf qu’aucune sanction n’a été prise en tous cas pour la zone 3. Non pas parce que le CCE ou le Congrès n’ont pas voulu prendre de sanctions, mais parce qu’il y a eu un vrai débat qui risquait d’entraîner une cassure à l’intérieur de toute une zone. Ce sont donc des questions très sérieuses qui ne peuvent pas être abordées dans des manuels scolaires tant que les témoignages et mémoires des témoins directs ainsi que la recherche scientifique n’ont pas donné la matière nécessaire pour comprendre ou travailler là-dessus.
Peut-on affirmer que ces non-dits sont le fait d’une génération qui est toujours au pouvoir ?
Ce n’est pas une question générationnelle. Nous avons des membres du gouvernement qui sont nés après 1962. Donc des gens qui n’ont rien à voir avec la guerre de Libération. Ensuite, la génération qui a entre 18 et 32 ans aujourd’hui est plutôt apolitique. Et dans cet apolitisme, il y a des propensions à oublier ou feindre d’oublier que l’une des questions fondamentales de l’Algérie contemporaine est celle de la souveraineté politique. C’est une génération qui, pour beaucoup, n’a rien à voir avec la question, ni de la patrie, ni de la Nation, ni du pouvoir souverain algérien. Et il y a beaucoup d’esprit de dépendance et de principe de subalternité par rapport au dominant et à son discours. Aujourd’hui, on se rend compte que chaque génération est contemporaine à elle-même au sens où elle n’a ni passé, ni futur. Tous les dix ans, une génération repousse celle qui l’a précédée et remet en question ses idéaux. La plupart des gens aujourd’hui n’ont plus de rapport avec leur passé ou ne veulent plus en entendre parler. Un rapport au passé qui est pourtant fondateur du présent et du futur d’une Nation.
Est-ce que les lignes commencent à bouger avec les nombreux livres publiés, chaque année, sur l’histoire de la guerre de Libération ?
Des lignes commencent à bouger. Plusieurs livres d’officiers de l’ALN de la wilaya III dont Djoudi Atoumi, Salah Mekacher, Hamou Amirouche et d’autres encore sont sortis ou sortiront bientôt. Ils abordent certaines questions. Mais ça ne passe pas dans le manuel scolaire. Nous sommes passés de l’amnésie à l’hypermnésie. L’hypermnésie est le retour du refoulé. On se met à vouloir parler, à tort et à travers, de tout et n’importe quoi. Tout le monde est amené à témoigner et à publier des mémoires et des biographies. Bien sûr, chacun a le droit de s’exprimer sous toutes les formes. Plus il y aura d’écrits, plus il y aura la possibilité de faire bouger les choses. Mais le problème est qu’on peut dire tout ce qu’on veut quand on n’est pas sanctionné par des experts. Dans la recherche scientifique, vous avez un jury composé de gens spécialisés qui vous donnent un avis sur vos sources, leur validité, leur utilisation. Vous avez donc une sanction quelque part de votre travail.
Comment expliquez-vous l’instrumentalisation de la guerre de Libération par le pouvoir et même par certains partis de l’opposition ?
D’abord, le 1er novembre 1954 est l’un des éléments fondateurs de l’Algérie contemporaine. D’une certaine façon la génération d’aujourd’hui ne peut pas se passer de ce moment fondateur. C’est comme renoncer à son père et à sa mère. Mais au-delà de cette question, les pouvoirs en place ont de l’autorité mais manquent de légitimité. Donc ils vont essayer de puiser dans l’histoire pour l’avoir parce que l’histoire est une réserve de légitimation. Ils n’arrivent pas à se légitimer par la « justesse » de leur politique, donc ils convoquent l’histoire à chaque moment. Or quand on travaille sur cette histoire à partir de documents d’archives et de sources vérifiées et vérifiables, encore une fois, on se rend compte que, dans les meilleures des cas, les autorités en place n’ont pas toujours eu une position honorable dans le passé. Et cette instrumentalisation de l’histoire est valable pour les autorités en place comme pour ceux qui voudraient les remplacer donc les différentes oppositions. Pourquoi ? Parce qu’ils n’ont d’alternatives ni politique, ni sociale, ni idéologique. Faire appel à l’histoire est symptomatique de l’absence de programme pour le futur. Quel est le programme alternatif à l’ultralibéralisme par exemple ? Qui présente une alternative ? Quelle figure charismatique serait la personnification de cette alternative ?
L’accès aux archives pose-t-il toujours problème pour les historiens en Algérie ?
La loi permet aux Algériens et aux Algériennes de consulter les archives car c’est un bien public. Donc allez demander à consulter une boite d’archives et à reproduire les documents. Faites l’expérience et racontez-la dans un article. Moi je vous dis qu’il y a des doctorants, particulièrement les Algériens, qui viennent en larmes. Parfois ce sont des pères et mères de famille qui viennent du fin fond du pays pour consulter un document. On leur dit qu’il faut avoir l’autorisation du directeur (du centre des archives) en personne. Ils louent une chambre d’hôtel et attendent que le directeur veuille bien les recevoir. Quand il finit par les recevoir, parce qu’il est souvent en mission ou en réunion, il leur donne son accord. Ces chercheurs arrivent dans les services, ils n’ont le droit de photocopier que trois feuillets par jour et quand ils amènent un appareil numérique pour photographier les documents, comme on fait dans beaucoup de fonds d’archives dans le monde, on leur dit que ce n’est pas autorisé. Quand la photocopieuse ne marche pas, ils sont obligés de repartir bredouilles après avoir dépensé des billets d’avion, des nuitées dans les hôtels, laissé leur travail. Cela veut dire qu’on n’arrive pas à travailler sur les archives. Celles-ci sont accessibles mais en partie. Bien évidemment, des fonds ne sont pas encore accessibles. Soit ils ne sont pas encore répertoriés et classés, soit ils sont mis sous réserve parce qu’on considère qu’ils sont très sensibles.