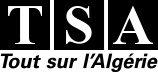Khaled Benaïssa est acteur, metteur en scène et producteur. Il vient d’obtenir le prix du meilleur acteur aux Journées cinématographiques de Carthage (JCC) en Tunisie pour son rôle dans L’Oranais, un film de Lyes Salem.
Que représente pour vous le prix que vous venez de recevoir en Tunisie pour L’Oranais ?
C’est la première distinction que je reçois pour mon rôle dans L’Oranais. En fait, un prix vous donne la possibilité de remercier les gens qui vous ont aidés. Il vous réconforte dans votre choix de scénario, de métier, de faire du cinéma. Un prix, ça vous encourage à aller de l’avant. C’est surtout des occasions de fêter notre travail. Le film est déjà sorti en France. Après les Journées cinématographiques de Carthage (JCC), il y a le festival du film engagé et on ne sait pas si L’Oranais y sera ou pas. Nous sommes aussi en train de penser à organiser une réelle sortie en Algérie. Aucune date n’a été arrêtée pour le moment, mais nous souhaitons le faire au courant de ce mois ou après les fêtes de fin d’année. Donc en janvier.
L’Oranais a suscité une grande polémique en Algérie. Comment l’expliquez-vous ?
En Algérie, le film a été projeté trois fois seulement (Bejaïa, Alger, Oran) en avant-première. La polémique a été provoquée par des gens qui n’ont pas vu le film. Des gens qui ont entendu dire que dans ce film, des Moudjahidine buvaient de l’alcool par exemple. Chose qui leur a permis d’écrire une dizaine d’articles et de faire des émissions de télévision. Il y a eu de la propagande et beaucoup de préjugés. Et ces gens ont même espéré interdire le film. Mais pour le faire, il faudrait qu’il soit diffusé et interdire un film n’est pas une chose facile. En fait, pour moi, il n’y a pas eu polémique, mais un débat social. J’ai entendu plusieurs personnes parler du film et je leur ai demandé où l’avaient-ils vu. Cela m’a donné l’impression qu’on a pris l’habitude de parler des choses qu’on ignore. D’ailleurs, on peut faire le même constat dans d’autres secteurs. Et je trouve cela triste mais surtout dangereux !
Avez-vous des appréhensions par rapport à la sortie du film en Algérie ?
Nous avons un visa d’exploitation de trois ans. Mais, quand El Manara (réalisé par Belkacem Hadjadj, 2004, NDLR) est sorti, il y a eu des appréhensions. Avec Le Repenti (réalisé par Merzak Allouache, 2012, NDLR), aussi. Nous ne produisons pas assez de films en Algérie. Et du coup, avec chaque film, le public a envie qu’on parle de tous les maux du pays, de ses espérances et de ses désespoirs. Et cela est impossible car une œuvre parle d’un contexte précis et propose un point de vue. En France ou aux États-Unis par exemple, on retrouve des films pour les jeunes et d’autres pour les moins jeunes par exemple, pour les gens de la gauche et pour ceux de la droite, etc. Nous sommes, nous et le public, des victimes. Nous sommes invités (en tant que cinéastes, NDLR) pour faire la promotion d’un film, mais il n’y a pas de salles de cinéma. Le public nous entend parler, pendant une heure, d’un film qu’il n’a pas vu et qu’il ne va pas voir. C’est frustrant !