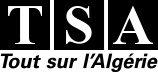Cette année-là, l’année qui précéda le chaos, ou celle qui le suivit, on ne sait plus, l’année de l’absurde, l’année du pyjama et de la Coupe du monde, une année froide et quelconque, cette année-là, dans ce pays sans mémoire, le pays de l’écrivain, cette année-là, les martyrs furent encore oubliés. Il ne s’était trouvé personne pour rappeler que c’était aussi leur année, l’année du soixantième anniversaire de l’insurrection, qu’il y avait comme un devoir d’évocation et que le président qu’on avait vu si enthousiaste à l’idée de célébrer, avec François Hollande, le centenaire de la Grande guerre 14-18 et faire ripaille à l’occasion de la qualification de l’équipe nationale de football pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, ce président-là aurait dû garder un peu de cette frénésie, juste un peu, pour commémorer sa propre guerre de Libération.
Mais non ! Les dirigeants de ce pays sans mémoire, un peu Cammora, un peu secte grabataire, ne voulaient plus de la mémoire, du passé, des mythes, les légendes, de tous ces rites sacrés qui leur rappelaient leurs parjures, les serments trahis et entretenaient les satanées fiertés identitaires. Pour eux, un peuple parfait est un peuple qui se suffit de l’illusion d’être libre. Ou de l’illusion d’être tout court. Un bon martyr est un martyr qui finit avec un nom gravé en tout petit sur une pierre tombale. Les martyrs comme le peuple ont une date de péremption : ils vivent le temps de l’usage qu’on en fait. Sans plus. Avant, ce n’est pas encore l’Histoire; après, ce n’est plus l’Histoire. Faites autre chose, des affaires par exemple ou passionnez-vous pour des occupations plus saines, les mots croisés, le football, c’est l’année de la Coupe du monde, ne l’oubliez pas… Avant, ce n’est pas encore l’Histoire; après, ce n’est plus l’Histoire.
Mais qui se doutait, au Palais ou dans Oran insouciante, de l’irrésistible obsession de l’écrivain qui allait tout faire basculer ? Il promenait dans Oran ses perplexités. « Cette histoire d’une guerre et d’un combat est dure, stricte, tranchée par la mort et la vie et ne permet pas encore de voir au-delà. » (1) Il voulait comprendre. Il ne voulait plus de « l’histoire algérienne réduite à la mesure de l’histoire du FLN ». « Avant » ou « pendant » il n’y avait rien ou que de la traitrise et de la tiédeur, se dit-il (1).
Mais à qui raconter, en cette époque d’insouciance fade, dans Oran où le drame n’était pas à la hauteur de l’Homme, comme du temps de la peste, quand au plus fort de l’absurde, au plus fort de l’épidémie, on avait continué à faire des affaires, de l’argent, une vie ordinaire, bien remplie – « du même air frénétique et absent » -, faite d’ennuis et d’habitudes, les mêmes promenades « sur le même boulevard », les mêmes restaurants bruyants et les mêmes terrasses de bistrots, Dieu et les affaires, cité de l’argent et des habitudes, où l’on n’avait pas vu venir cette saison fatidique qui emporta la Nation. Tout avait pourtant été annoncé par Camus, se répétait alors l’écrivain avant de pénétrer dans ce bar où l’attendait une rencontre aussi irréelle que le peuple.
Le frère de l’Arabe, qui avait déjà quelques bières dans l’estomac, ne lui avait en fait rien appris qu’il ne savait déjà. L’écrivain, du reste, ne cherchait pas des informations mais un apaisement. Il mit quelque cœur à apostropher son nouveau compagnon de bar. « Tu peux retourner cette histoire dans tous les sens, elle ne tient pas la route. Ton frère est le deuxième personnage du roman, le plus important, mais n’a ni nom, ni visage, ni paroles. Et puis… C’est l’histoire d’un crime, mais l’Arabe, ton frère, n’y est même pas tué – enfin, il l’est à peine, il l’est du bout des doigts. » (1)
Le garçon avait apporté deux autres bières et le frère de l’Arabe avait laissé tomber une réponse blasée : « Mon frère avait-il besoin d’être tué pour ne plus exister ? Il n’était déjà pas de ce bas monde. Pas de nom, ni de visage, ni de mère. On dit qu’il est mort de la main de Meursault, dit-on. N’en crois rien. Il était déjà mort. Le mal de notre guerre, ce n’est pas de nous avoir jetés dans la mort, c’est de ne pas nous avoir ressuscités avant. Regarde bien : nous portons notre inexistence de générations en génération jusqu’à l’inscrire sur des banderoles : ‘Vous ne pouvez pas nous tuer, nous sommes déjà mort !’ »
L’écrivain avait lâché, machinalement : « Tu fais diversion avec la révolte kabyle… Pour la première fois le frère de l’Arabe avait esquissé un sourire : Je ne parle pas des kabyles, mais de la progéniture des enfants qui disputaient la nourriture aux rats, autour des poubelles, à Tizi-Ouzou…Oui, Camus avait tout… Tu ne crois pas qu’il a fait tuer l’Arabe non pour l’éliminer mais pour le révéler à son inexistence ? Je ne sais pas, l’ami. Comme je ne sais pas qui de mon frère ou moi est le plus mort. Voilà soixante ans que je me demande s’il n’aurait pas été préférable de mourir avec Meursault plutôt que de vivre avec les nouveaux maîtres… Mais il se fait tard, je dois partir… Á demain, même heure ».
Á SUIVRE.
(1) Extraits d’écrits de Kamel Daoud