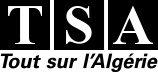Il est un pont entre les deux rives de la Méditerranée, un symbole entre l’Algérie et la France. Le 29 mai dernier, l’université de Blida a rendu hommage à l’un des grands anciens de la ville. En présence de membres du gouvernement, Jean Daniel le fondateur du magazine français le Nouvel Observateur, a été fait Docteur Honoris Causa de l’université blidéenne. À cette occasion, celui qui est né à Blida a prononcé un discours en direction de ses « chers compatriotes ». C’est ce discours que je vous propose de retrouver in extenso tant il puise aux sources de l’Algérie. Jean Daniel, compagnon d’Albert Camus, a été un acteur majeur de soutien à l’Algérie combattante et indépendante. Extraits : « Chers Compatriotes ! Cette expression n’a d’ailleurs rien d’outrecuidant puisque ma vie s’est déroulée comme un jeune amoureux de l’Algérie française, comme un militant de l’émancipation maghrébine et, enfin, comme un témoin engagé à tous les stades de la Révolution algérienne.
Reste que me voici devant vous aujourd’hui, presque centenaire, et partout où l’on m’invite je suis sûr d’être le doyen. Sans doute ne suis-je ni arabophone, ni arabisant. J’ai eu le tort de laisser ce soin à mes amis les plus proches, ceux dont je redoute de ne pouvoir les citer tous au cours de cet exposé. De toutes façons, et grâce à l’indulgence de vos commentaires sur mon parcours, vous avez généreusement justifié le privilège dont je suis ici, grâce à vous, le bénéficiaire. Chers Compatriotes, laissez-moi vous rappeler cependant que les miens sont enterrés dans ces lieux depuis des siècles, que mon père baragouinait l’arabe et que je l’entends encore dialoguer en berbère avec les clients qui, le vendredi, descendaient des montagnes de Chréa vers notre minoterie. Il m’arrive souvent, aujourd’hui encore et peut-être plus que lorsque j’étais jeune, de me souvenir avec une précision désarmante de tous les lieux, et d’abord ceux qui ont inspiré nos poètes, en y retrouvant la fameuse « ferveur ».
Je m’enchante de pouvoir partager, avec Hanna ma petite-fille que j’ai pris soin d’emmener, le frisson de conte de fées que j’avais dans le jardin qui s’appelait encore Bizot, en m’engouffrant dans certains arbres, et plus tard en me plongeant dans mes méditations. Tout le monde ne savait pas -mais le savent-ils aujourd’hui ?- combien de précieux recoins se dissimulaient dans la végétation savamment désordonnée de ce jardin.
C’est un plaisir que je me fais à moi-même en évoquant tous ces noms, tous ces lieux, et je peux encore sentir le parfum sucré du chèvrefeuille, et bien sûr celui de la fleur d’oranger. En fait, je n’ai pas cessé d’écrire sur l’Algérie sans que toutes ces évocations involontaires me viennent naturellement. C’est peut-être en cela que je suis le plus un véritable Blidéen.
Puisqu’il faut passer aux grandeurs et aux servitudes de notre pays, je rappellerai que les vingt premières années que j’ai connues, c’est-à-dire au début de mon siècle qui avait 20 ans, il n’a été question que de guerres avant que ne surgissent les révolutions.
À Blida, pendant toutes ces années, il y a eu cependant des époques de suspension de la haine et des armes. J’ai participé à des batailles de fleurs et mon père ne cessait de raconter comment il avait enlevé, je dis bien « enlevé », sa femme au cours de l’une de ces batailles, avant de lui faire pas moins de onze enfants. Je suis le onzième et le dernier survivant.
Qu’est-ce que nous apprenions alors au « Collège colonial » de Blida sur notre ville et sur notre pays ? Bien sûr, à lire, à écrire, à compter, à réciter, parfois même à dessiner, c’était une base déjà solide pour nombre de petits enfants de naissance très modeste. Mais sur notre ville et sur notre pays, pratiquement rien. Lorsqu’il s’agissait de l’histoire, on entendait vaguement parler de ces héros depuis Vercingétorix jusqu’à Napoléon. Mais nous n’en retenions même pas les noms avant le certificat d’études. Un jour, nous avions remarqué qu’un jeune professeur avait épinglé sur certains cartons des portraits de Massinissa, de Juba et de la Kahina. Mais nous ne savions pas de qui il s’agissait. C’était un mystère pour tout le monde, et d’abord pour nos professeurs français.
Les maîtres qui m’ont aidé plus tard non pas à apprendre mais à comprendre ce que l’on peut appeler l’arabo-islamisme, ce sont d’abord Charles-André Julien, lui-même né en Algérie, comme les professeurs Jacques Berque, Charles-Robert Ageron et Maxime Rodinson. Mais je suis sûr que je réveille bien des souvenirs chez les jeunes gens que vous avez été en évoquant la publication d’un livre dont le titre était « L’Afrique du Nord en marche ». Un sous-titre était expressif : « Histoire et nationalisme maghrébins contre la France ».
Pour des centaines de jeunes gens qui allaient jouer un rôle important dans toutes les étapes de l’émancipation du Maghreb, il s’agit d’un livre–clé devenu pour moi un livre culte. Chaque fois qu’il est arrivé un événement particulier – qu’il s’agisse des polémiques sur le nombre des morts dans les attentats, dans la répression ; qu’il s’agisse des responsabilités dans les occasions pacifiques d’apaisement ; qu’il s’agisse même et surtout du grand conflit autour des propos de Ferhat Abbas et des Amis du Manifeste –, Charles-André Julien a été le premier à nous informer, et je dois dire plutôt à nous déniaiser.
Car nous ne savions rien de rien. Et c’était le cas de quelques jeunes musulmans qui allaient jouer un grand rôle dans la future résistance.
Qu’est-ce que nous apprenait Charles-André Julien ? Que le nationalisme n’avait cessé d’être présent dans tout le Maghreb sous des formes diverses, et que la pacification n’avait jamais été complète dans certaines régions ?
L’historien nous a appris aussi l’histoire de Ferhat Abbas qui est passionnante, et que je vous conseille à nouveau, parce qu’elle révise tant de préjugés. Et par exemple, on est en train de découvrir que le nationalisme, pas seulement autour de lui, avait commencé de conceptualiser sa stratégie et d’envisager des formes de combat qui n’étaient pas systématiquement violentes. Lisez le dernier livre de notre ami Jean Lacouture, « Le manifeste du peuple algérien, suivi de Rappel au peuple algérien de Ferhat Abbas et Jean Lacouture » et à qui j’adresse en votre nom nos meilleurs souhaits.
Qu’est-ce qu’un Algérien ? J’ai assisté à des discussions passionnantes et surtout passionnées sur le sujet. D’un côté, il y avait ceux pour qui le premier président de la République avait tout dit, c’était Ben Bella, et sa formule était courte :
« Nous sommes des Arabes, nous sommes des Arabes, nous sommes des Arabes ! »
Les Français, même initiés, ont pris cela pour un cri de guerre contre la France, un nouveau cri de guerre. En fait, Ben Bella avertissait qu’il ne tolérerait pas qu’une dimension kabyle berbérise la Révolution.
Permettez-moi d’évoquer un souvenir. J’étais très lié avec l’écrivain algérien Yacine Kateb, qui était en même temps qu’un grand écrivain, l’être le plus attachant et le plus sujet aux caprices et aux humeurs. Je l’ai accompagné un jour parce que Jean-Marie Serreau avait mis en scène une de ses pièces. Mais il a eu l’imprudence de présenter Yacine comme un grand romancier arabe.
Yacine n’a fait qu’un bond et il a déclaré à voix très haute « Je n’aime pas beaucoup me laisser enfermer dans l’arabisme. J’ai participé à une résistance nationaliste contre le colonialisme français, mais je l’ai fait comme un Algérien et non comme un Arabe. J’ai voulu reconquérir l’algérianité perdue, je n’ai pas voulu me fondre dans l’univers arabo-islamique. » Sous les protestations, souvent les plus amicales, il a corrigé le tir, mais il a proclamé à la fin des fins : « Non, non, je ne veux pas qu’on mutile mon algérianité en mélangeant mes racines à celles de n’importe qui ». Je lui ai dit que tout de même il ne pouvait pas nier qu’il appartenait à l’univers arabo-musulman, et il a répondu : « Il reste que, si je me réfère à une nation, c’est à mon Algérie. Et que si je tends vers l’universel, c’est celui de tous les idéaux de l’Islam, du judaïsme, du christianisme, des révolutionnaires, des humanistes et puis des poètes, surtout des poètes.»
Bien plus tard, c’est-à-dire récemment, le débat sur l’universel s’est déchaîné avec celui de l’opportunité de la violence, de la compatibilité de l’Islam et de la démocratie. Et il m’est arrivé une chose singulière. Je venais de publier un livre, « La prison juive », qui provoquait des commentaires souvent sévères. Un grand ethnologue de l’Arabie médiévale, le professeur en Sorbonne Mohammed Arkoun, a écrit : « Je ne suis pas sûr d’être en mesure de mettre en question l’Islam comme vient de le faire Jean Daniel pour le judaïsme ». Cette réflexion était sans doute amicale, mais on devine qu’elle n’a pas plu à tout le monde et dans tous les milieux juifs et musulmans.
Le débat n’a pas été trop cruel et nous avons eu l’occasion, lui et moi, de rencontrer de grands experts qui avaient le souci de concilier nos recherches.
Ce que je n’ai pas dit encore, depuis le début de cet exposé, c’est l’affection admirative et la gratitude respectueuse que j’ai eues pour cet homme, au point que je me suis mis à lire des réflexions incroyablement hermétiques et des recherches terriblement intimidantes. Mais cet homme, Mohammed Arkoun, avait l’impression d’avoir trouvé quelque chose.
Tous ces réformateurs de l’Islam dont on déplorait d’absence, tous ces Luther, Calvin solitaires et même ces Pascal, on pouvait les retrouver dans l’Islam deux siècles après les premières diffusions du Coran. Les principes de 1789 qui, en France, ont donné la liberté, l’égalité, la fraternité, on pouvait les retrouver dans la correspondance entre Averroès, Maimonide et Saint-Augustin.
Naturellement, il n’est pas question de tout cela dans les débats sur les élections européennes. Et à ceux que préoccupe ce que va devenir la France multiculturelle, je veux dédier cette citation du professeur Jacques Berque, écrite à la fin de la guerre d’Algérie sur l’avenir des relations entre la France et l’Algérie : « On ne s’est pas entrelacé pendant cent trente ans sans que cela descende très profondément dans les âmes et dans les corps. La profondeur de l’impact français a dépassé ici, et de loin, les aliénations habituelles du colonialisme, de l’exploitation coloniale et du mercantilisme. Grande chance et grand malheur, d’où la violence et le ressentiment… que je crois que, pour l’avenir, la solution franco-maghrébine ne réside pas dans la transaction mais dans l’expiation double et partagée. »
Ainsi a conclu Jean Daniel, le journaliste de Blida sous les applaudissements nourris dans son université natale. Un moment fort de communion et d’intelligence entre les hommes.