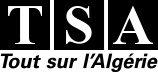Amel Boubekeur est spécialiste du Maghreb et des questions de l’Islam en Europe. Elle est chercheuse au Centre Jacques-Berque. Dans cet entretien, elle analyse les résultats de la présidentielle et l’évolution des rapports de force au sein du pouvoir et dans la classe politique.
Quelle lecture faites-vous des résultats de l’élection présidentielle du 17 avril ?
Ils ne constituent pas une surprise, même si l’ensemble des commentateurs s’attendaient à un résultat un peu moins surréaliste. Les élections n’étaient pas tant importantes par rapport aux résultats que par rapport à la redéfinition ou la reconfiguration des différentes alliances entre candidats et au niveau du système de gouvernance, vu l’état de santé du Président. Ces élections étaient également importantes pour le régime puisqu’elles lui ont permis de voir si ces nouvelles bases sociales clientélistes, qui ont remplacé celles vieillissantes du FLN, seront mobilisables dans l’avenir. Et puis, ces élections marquent la fin de la démocratie de façade. Même si les puissances occidentales se sont empressées de congratuler Abdelaziz Bouteflika, on ne pourra plus dire, dans l’avenir, que bien que l’Algérie ne soit pas tout à fait une démocratie, il y a quand même des élections pluralistes. Les Algériens ne pourront non plus se raccrocher à l’image d’un Président « civil ». Maintenant, il faut trouver d’autres récits de légitimation du régime tant au niveau interne qu’au niveau externe.
Comment se fera cette reconfiguration des alliances au sein du pouvoir ?
Le système fonctionne, depuis quinze ans, avec une gouvernance hyper-présidentielle, mais le Président n’est plus en état de gouverner aujourd’hui. Une vacance physique du pouvoir qui déséquilibre le schéma en place. Donc, il s’agit d’une reconfiguration de facto. D’une part, il y a l’idée de réunir une opposition qui a gardé des liens privilégiés avec le DRS et qu’Ali Benflis semble vouloir chapeauter. Une opposition qui ne sera pas dans la cooptation directe, mais qui conduira un dialogue labélisé comme transitionnel avec le pouvoir. D’autre part, il y a l’idée que le rôle du DRS soit moins important publiquement et qu’une jeune armée professionnalisée et neutre soit prête à reprendre le flambeau. Je pense qu’on va aller vers encore plus de redistribution rentière et irrationnelle pour pouvoir corrompre socialement les demandes de changement. Mais le problème, et on le verra, c’est que plus de promesses il y a, plus de promesses non tenues il y aura. C’est le début d’un long cycle de négociation entre le gouvernement, l’opposition et la population.
Donc, l’opposition dont fait partie la Coordination nationale pour le boycott ne pourra pas imposer une transition ?
Je ne peux pas vous répondre tant que ces acteurs restent dans l’appel à la transition ou au rassemblement et des processus de consultation sans fin alors que cela fait quand même 20 ans qu’ils évoluent dans la même sphère. En revanche, je pense que pour que cela fonctionne, il faudra aller au-delà des appareils partisans. Ce qui a fait l’échec de la CNDC (Coordination nationale pour le changement et la démocratie) en 2011 est le fait de limiter la négociation avec le pouvoir à des structures partisanes. Il faut sortir aussi de cette dualité où on retrouve d’un côté l’opposition et d’un autre le pouvoir. Je pense que ces partis d’opposition ont besoin d’acquérir des mécanismes de contrainte qui obligent, l’État à être redevable.
Quels sont ces mécanismes ?
Globalement, il s’agit de se réapproprier les institutions, comme le Parlement ou la Commission nationale indépendante de supervision des élections (Cnisel), pour faire en sorte que les recours aboutissent, par exemple. Mais cela ne se fera pas sans mobiliser les gens sur le terrain, les institutions en tant que telles étant des coquilles vides. Il faudra que ces partis arrivent à considérer la société civile comme un acteur politique et par entière et pas uniquement comme un marchepied pour s’imposer face au régime comme des acteurs « représentatifs ». Il est difficile pour ces partis d’être crédibles face aux Algériens en ne se mobilisant que deux mois avant le début de la campagne électorale. Cela étant dit, une chose intéressante a été relevée par Benflis et par la Coordination nationale pour le boycott : le refus de la fraude. Il s’agit d’un positionnement assez inédit pour des gens du système. Maintenant, s’ils ne vont pas au bout, ce sera là aussi problématique pour mobiliser à l’avenir.
Quelles sont les conditions nécessaires pour une véritable transition en Algérie ?
Il faut des garanties et une clarification du rôle de l’armée et des forces de sécurité dans le champ politique. C’est un point absolument nécessaire pour que les Algériens sachent qu’ils ne risquent pas d’être réprimés s’ils s’engagent en politique. Ensuite, il est également nécessaire de garantir une transition non violente. C’est ce point qui fera basculer l’immense majorité des Algériens en faveur d’un changement. Enfin, il ne faut pas constamment recycler les mêmes acteurs politiques et compter sur la logique des personnalités, plutôt que sur celle des programmes d’actions concrètes.
Est-ce que le DRS continuera à jouer un rôle après les changements décidés par le président de la République ?
Je pense qu’on ne peut pas faire disparaitre, du jour au lendemain, une institution comme le DRS et ses prérogatives. Ce n’est pas possible sur le plan structurel ou idéologique.
Certains analystes estiment qu’un regain de violence est inéluctable en Algérie…
Cette approche de l’Algérie par les extrêmes empêche de comprendre les vrais enjeux. Entre les prédictions d’inéluctable apathie ou soulèvement violent, il y a quand même un peuple et sa pluralité. La violence fait déjà partie de la société algérienne. Il faut arrêter d’en faire une menace liée au changement politique et regarder en face ce qui est déjà là. Prenez ce que l’on appelle les émeutes socioéconomiques, alors qu’elles sont, à mon avis, profondément politiques. Celles-ci existent et elles continueront d’exister. À Ghardaïa, il ne s’agit pas prioritairement de violences intertribales comme on nous les a présentées, mais c’est une violence née de la défaillance de l’État. Pour que la violence comme moyen de négociation avec l’État cesse, il faut que les citoyens ressentent qu’ils peuvent avoir un impact sur ceux qui les dirigent par d’autres moyens. Il y a, aujourd’hui, un manque de confiance en soi sur l’impact qu’ils peuvent avoir en se constituant en citoyens et pas uniquement en clients de l’État. C’est là un chantier prioritaire pour les partis politiques que vous évoquiez et qui qualifient aujourd’hui un changement de gouvernance comme une condition de survie du pays.